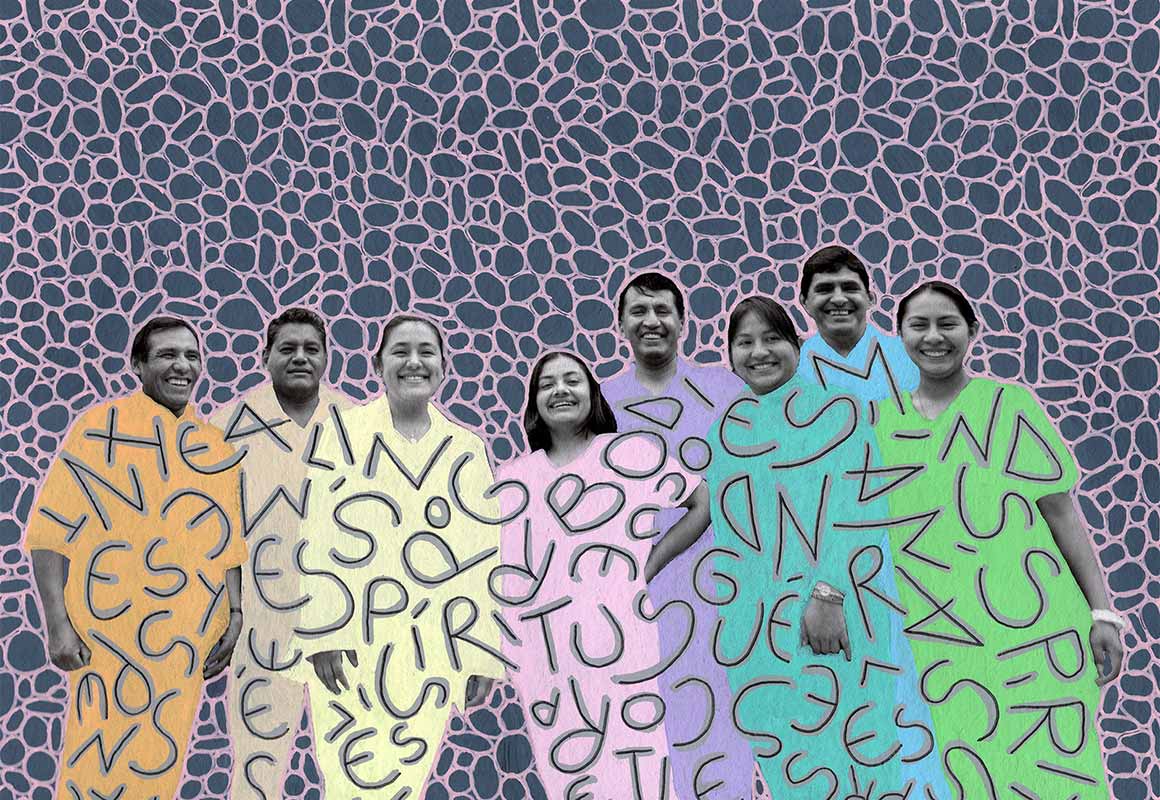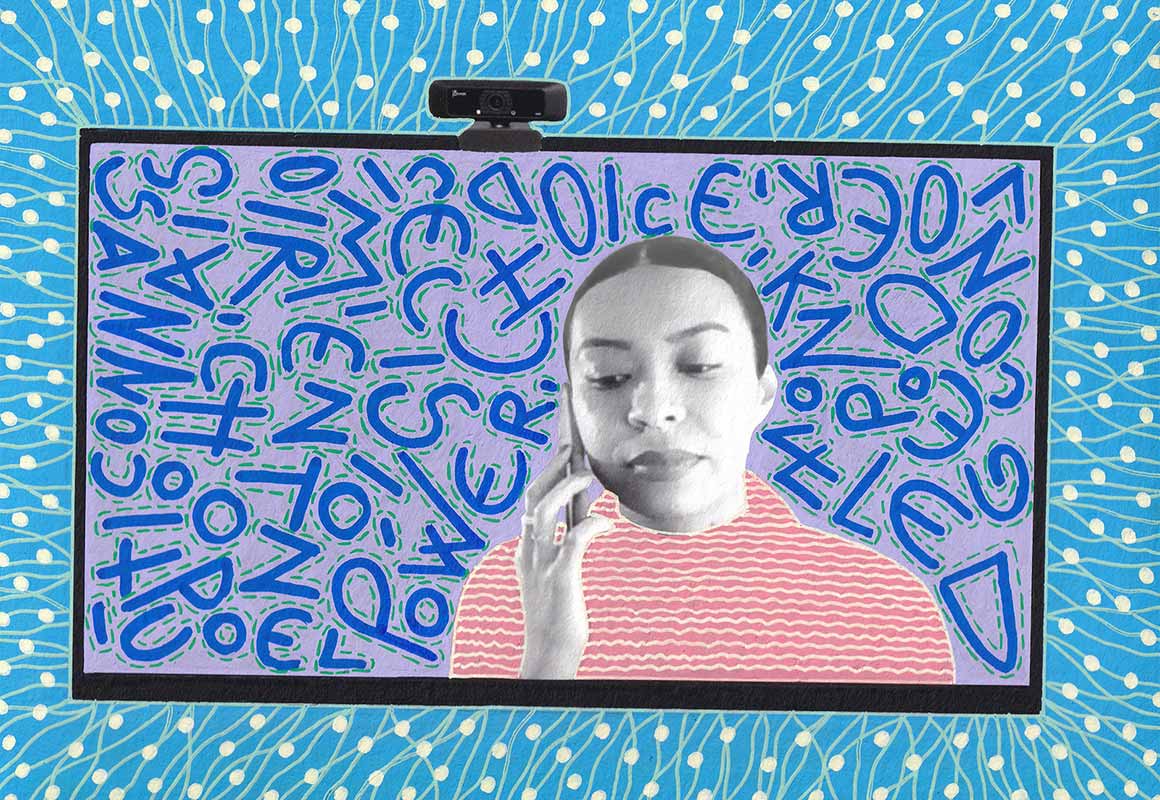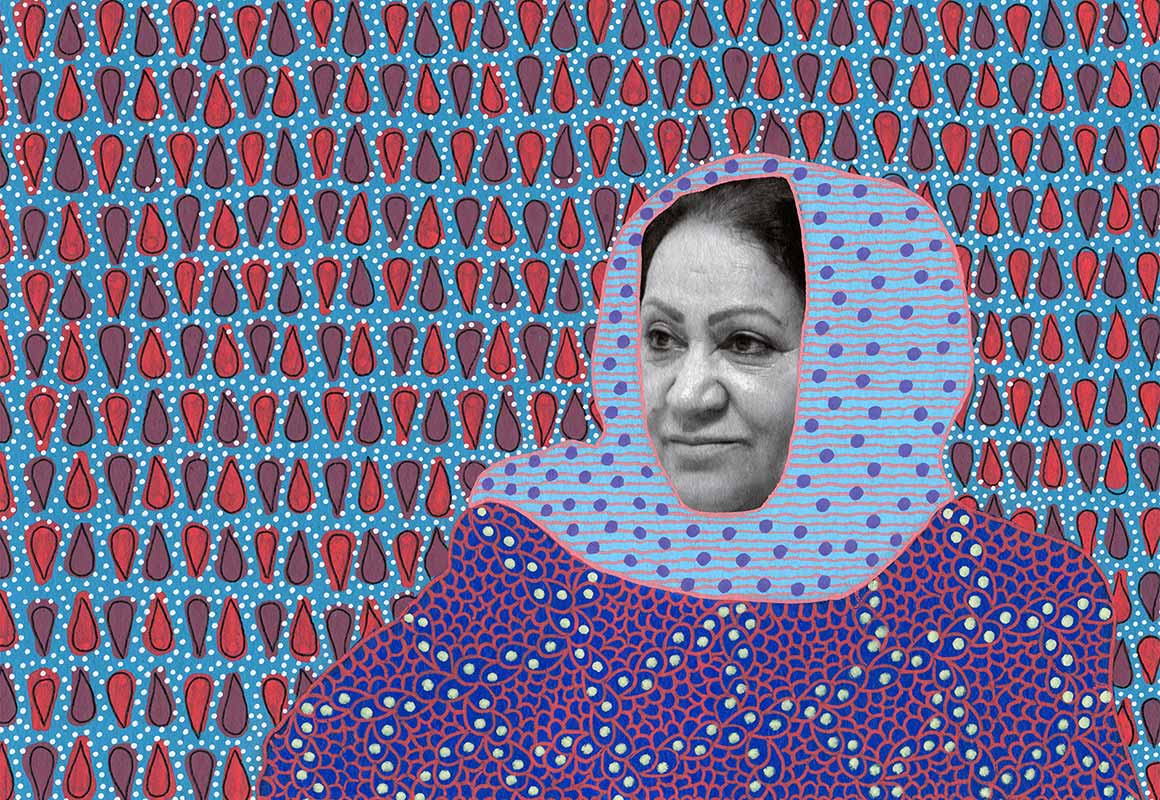« Ce n’est qu’après être devenue professionnelle du sexe que j’ai vraiment appris que j’avais mon mot à dire et que j’étais maîtresse de mon corps
», explique Liana par l’intermédiaire d’un interprète en Indonésie.
Liana a l’habitude de faire voler en éclats les idées préconçues : ancienne comptable diplômée et issue de la classe moyenne, elle ne correspond pas au stéréotype de la professionnelle du sexe. « Quand mon bébé avait quatre mois, mon mari est décédé », raconte‑t‑elle. Ses revenus n’étaient pas suffisants, l’entreprise familiale marchait mal, et sa sœur avait des difficultés financières.
« Je me suis rendue dans l’un des établissements bien connus de l’industrie du sexe et j’ai postulé pour y travailler », confie‑t‑elle, en soulignant que cela relevait de sa propre décision. « Je l’ai fait en toute indépendance et sans y être forcée. »
Aujourd’hui, Liana est la coordinatrice nationale du réseau OPSI, qui plaide la cause des professionnel(le)s du sexe et leur propose différents services, notamment de santé. Le réseau bénéficie du soutien de l’UNFPA. « En réalité, les professionnel(le)s du sexe présentent une grande diversité », explique‑t‑elle. « Il y a des hommes, des personnes transgenres, et les raisons qui incitent à choisir de se lancer dans l’industrie du sexe varient d’une personne à l’autre. La majorité cherche une source de revenus. »
Monika, en Macédoine du Nord, est devenue professionnelle du sexe après avoir perdu son emploi et divorcé. Elle aussi affirme avec conviction que c’était sa décision. « J’avais 19 ou 20 ans. J’étais assez mûre et assez consciente pour réfléchir à ce que je voulais et à ce que je ne voulais pas. » Aujourd’hui coordinatrice régionale de l’organisation STAR, premier collectif de professionnel(le)s du sexe dans les Balkans et également partenaire de l’UNFPA, elle dit avoir observé que c’est la norme : « La plupart du temps, je suis entourée de professionnel(le)s du sexe qui se sont volontairement lancé(e)s dans cette activité. »
Néanmoins, Liana et Monika reconnaissent toutes deux que la traite à des fins d’exploitation sexuelle (par la force, la coercition, l’escroquerie ou la tromperie) constitue un problème grave au sein de cette industrie. Leurs organisations respectives travaillent en étroite collaboration avec les victimes et les personnes survivantes, qu’elles aident à bénéficier de services et à quitter l’industrie du sexe si tel est leur souhait.
Compte tenu de la prévalence de l’exploitation et des abus, les débats portent en grande partie sur le statut légal du travail du sexe. Partisans de la dépénalisation et opposants invoquent tous deux la nécessité de protéger ces personnes des abus.
Toutefois, aux yeux des opposants, la notion même de consentement dans l’industrie du sexe est problématique. En effet, des études montrent que les personnes qui se lancent dans cette activité sont nombreuses à présenter des vulnérabilités accrues : elles ont souffert de la pauvreté pendant l’enfance, connu la maltraitance et l’instabilité familiale, ou encore rencontré des obstacles pour accéder à l’économie formelle, notamment parce qu’elles n’étaient pas suffisamment instruites (McCarthy et al., 2014). Ces conditions sont considérées comme un facteur compromettant leur consentement libre et éclairé. En outre, une part importante des professionnel(le)s du sexe (estimée entre 20 et 40 %) indique avoir intégré l’industrie du sexe dans l’enfance (Parcesepe et al., 2016), ce qui constitue une violation manifeste de leurs droits fondamentaux.
Les instruments relatifs aux droits fondamentaux se sont attaqués à ces vulnérabilités. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes appelle ainsi à prendre « toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes ». Quant aux protocoles de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, leur définition de l’expression « traite des personnes » englobe notamment « l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ».
Néanmoins, de nombreux défenseurs des professionnel(le)s du sexe avancent que cette focalisation sur la question de la vulnérabilité compromet leur sécurité et leur autonomie. Liana et Monika affirment toutes deux avoir librement choisi de continuer à travailler pour l’industrie du sexe alors même qu’elles gagnaient un revenu décent en dehors de ce secteur.
« Je vous en prie, ne partez pas du principe que la totalité des professionnel(le)s du sexe sont victimes de traite. Il existe des personnes comme moi qui choisissent ce travail de leur plein gré. Personne ne nous manipule », prévient Liana. « Quand on demande aux membres de l’OPSI s’ils souhaiteraient cesser ce travail dans l’éventualité où ils pourraient trouver un autre emploi, la plupart du temps, la réponse est non. » Les autres emplois à la disposition des professionnel(le)s du sexe sont souvent peu rémunérés, explique‑t‑elle, et l’industrie du sexe permet une flexibilité que beaucoup trouvent intéressante. « Ils peuvent gérer eux‑mêmes leurs horaires. Ça leur permet de s’acquitter de leurs obligations sociales et d’être plus proches de leurs enfants. »
Le travail du sexe, ou en tout cas certains de ses aspects (la coordination, par exemple), est illégal dans la majorité des pays, selon le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe. Liana et Monika estiment que ces lois ont pour seul effet de condamner la profession à la clandestinité, une situation dans laquelle les professionnel(le)s du sexe ont plus de mal à repérer les clients violents. Elles assurent que cette criminalisation expose également les professionnel(le)s du sexe aux arrestations, les rendant moins susceptibles de dénoncer d’éventuels agresseurs. En outre, les professionnel(le)s du sexe sont parfois victimes de harcèlement et d’abus de la part de certains policiers qui, « sachant que le travail du sexe n’est pas légal, se disent qu’on ne pourra pas les dénoncer et qu’on sera abandonné(e)s à notre sort », alerte Monika.
Ce qu’elles veulent, c’est la criminalisation de l’exploitation et des violences sexuelles ainsi que la poursuite de leurs auteurs, et non la pénalisation du travail du sexe. « Le problème de la violence ne touche pas seulement les professionnel(le)s du sexe. Il concerne toutes les femmes et les groupes minoritaires », souligne Liana.
Depuis quelques années, le mouvement visant à dépénaliser le travail du sexe gagne du terrain aux Nations Unies, et de nombreux organismes et programmes, notamment l’OMS et ONUSIDA, y voient un moyen efficace de prévenir la transmission du VIH et de mettre fin à la discrimination à l’égard des populations vulnérables (OMS, 2014 ; ONUSIDA, 2012).
Par ailleurs, les Nations Unies redoublent d’efforts pour éliminer l’exploitation et les abus sexuels. L’institution, préoccupée par les rapports d’exploitation entretenus par certains soldats de la paix et travailleurs humanitaires avec des professionnel(le)s du sexe et des personnes vulnérables et marginalisées, a renforcé la surveillance de l’application des règles interdisant au personnel d’échanger de l’argent, des biens ou des services contre des rapports sexuels, y compris dans les pays où le travail du sexe est légal. D’après les représentants des Nations Unies, il n’y a aucune contradiction entre la position selon laquelle la dépénalisation contribuerait à préserver la santé et les droits des professionnel(le)s du sexe et celle consistant à interdire aux membres du personnel d’acheter des services sexuels, même lorsque cette pratique est légale.
« Le personnel des Nations Unies ne doit participer à aucune activité susceptible de conduire à l’exploitation sexuelle. Cette interdiction ne constitue pas un jugement à l’égard du travail du sexe pratiqué par des adultes informés et consentants, mais nous devons reconnaître que la légalité ne suffit pas à garantir que la participation à l’industrie du sexe est volontaire », explique Eva Bolkart, qui coordonne le travail de prévention de l’exploitation et des abus sexuels mené par l’UNFPA.
Monika et Liana conviennent que la légalité n’est pas suffisante, et estiment que la dépénalisation doit s’accompagner d’une déstigmatisation. Tant qu’on ne traitera pas les professionnel(le)s du sexe avec le même respect et la même dignité que les autres citoyens, ceux‑ci resteront contraints d’exercer dans la clandestinité, une situation propice à la dissimulation des abus. « Nous sommes des parents. Nous avons des parents. Nous avons des familles », argumente Monika. « Il n’y a pas de raison que nous soyons traité(e)s différemment des autres à cause de la profession que nous avons choisie. Le travail du sexe est un travail comme un autre. »